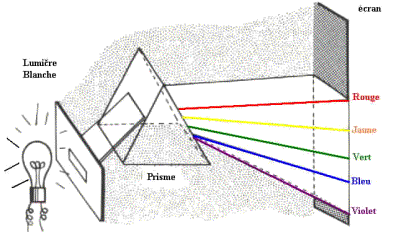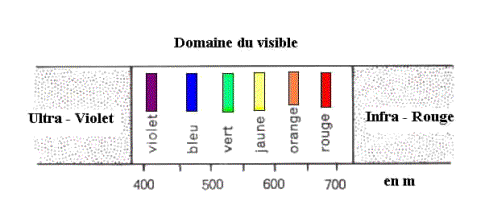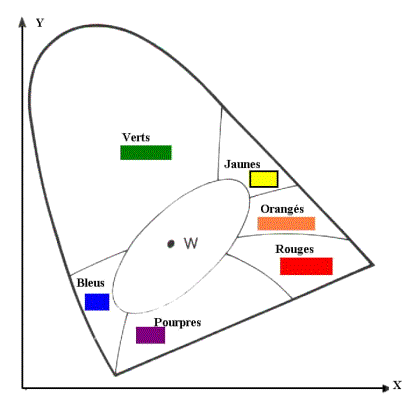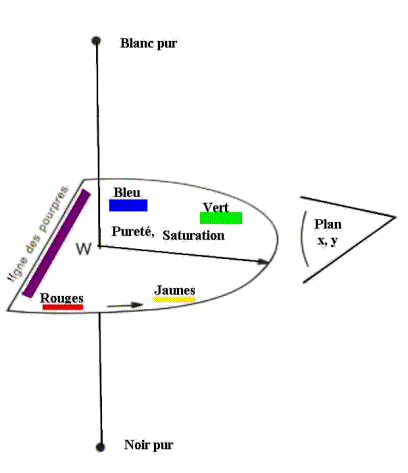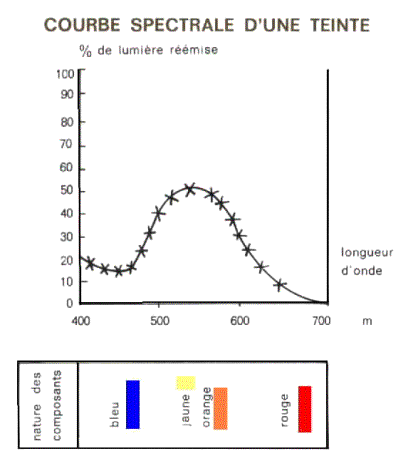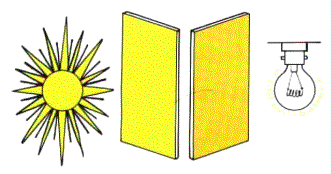|
La colorimétrie
est une science permettant la mesure des couleurs et par-là, des écarts
de couleur entre deux teintes données
1. Caractéristiques
et composition de la lumière.
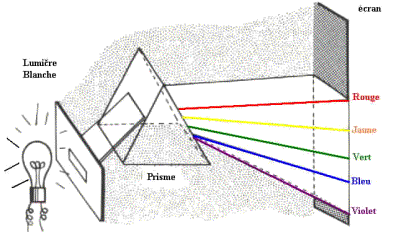
2. Décomposition de
la lumière blanche par un prisme.
En physique, la lumière est considérée
comme une vibration électromagnétique rattachée à une fréquence, donc
à une longueur d’onde. Elle est caractérisée par deux valeurs mesurables :
longueur d’onde et intensité.
La lumière blanche (Lumière du
jour) est formée par un mélange de lumière de longueur d’onde différentes.
Le prisme d’un spectrographe la décompose en faisceaux monochromatiques
(une seule longueur d’onde).
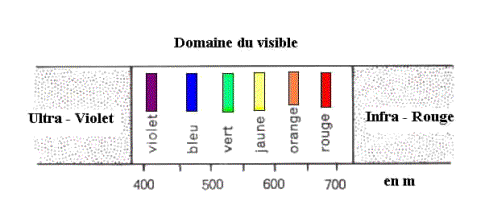
Spectre Visible
Le domaine du visible s’étend
entre les longueurs d’onde de 0.38 à 0.72 micron, les longueurs
d’onde les plus courtes étant du domaine de l’Ultra - Violet,
les plus longues de l’Infra - Rouge.
3. Observation des couleurs.
Lorsqu’un rayon lumineux de
lumière blanche, éclaire un objet coloré, la couleur de l’objet
absorbera toutes les couleurs du rayonnement qui ne seront pas de sa
propre teinte. Cette couleur non absorbée se trouvera réfléchie et c’est
elle seule qui sera perçue par l’œil.
Exemple : Une couleur
verte absorbe les radiations bleues, jaunes, oranges, rouges et ne
renvoie que les radiations vertes qui atteindront l’œil
et nous feront dire l’objet examiné est vert.
La nature de la lumière incidente est très importante dans la perception
des couleurs : prenons pour source lumineuse une lampe à vapeur
de sodium qui émet une lumière jaune orangée pratiquement monochromatique
(longueur d’onde 0.589 micron) donc très différente de la lumière
blanche, formée par l’addition de toutes les lumières comprises
entre l’Infra - Rouge et l’Ultra - Violet. Le même objet
vert apparaîtra noir car il ne peut transmettre une couleur qui n’existe
pas dans cette source lumineuse.
4. Rôle de l'œil
dans la vision des couleurs.
L’œil rattache à une
couleur donnée trois caractéristiques :
Ø
La teinte : Elle correspond à une sensation
colorée, bleu, rouge, vert, etc…
Ø
La pureté : Elle s’identifie au fait que la teinte
peut apparaître plus ou moins lavée par du blanc.
Ø
La clarté : (appelée aussi luminance, intensité, vivacité)
est liée au fait que la sensation de couleur est plus ou moins intense,
plus ou moins violente.
L’œil ne peut chiffrer
aucune de ces caractéristiques mais décèle l’égalité ou l’inégalité
des sensations produites par diverses couleurs :
Ø
Il apprécie des différences d’intensité de deux
sensations ayant même teinte, même pureté :
Ø
Il juge si deux couleurs de même intensité, même pureté
sont de même teinte.
5. Mesures colorimétriques.
Le rôle de l’appareil de colorimétrie
(spectrophotocolorimètre) sera de chiffrer une couleur ou une différence
de couleur par rapport à un type donné.
Dans
l’examen d’une teinte, pour un source de lumière étalonnée,
le colorimètre permet la mesure des quantités X, Y, Z de lumière ré
émise bleue, verte, rouge, appelées composantes tri chromatiques
Par le
calcul, on déduit les coordonnées tri chromatiques x, y qui permettent
une représentation graphique dans le plan.
6. Plan des Couleurs.
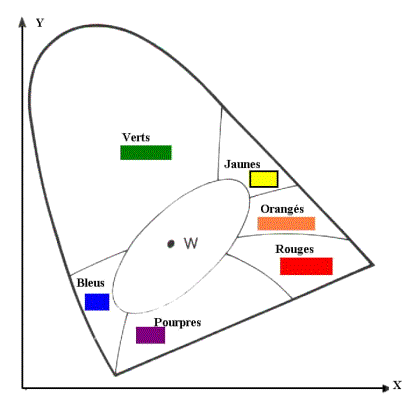
Ø
Toutes les couleurs sont représentées par un point
à l’intérieur de la courbe imprimée en caractères gras. Il n’existe
pas de couleurs à l’extérieur.
Ø
Chaque zone a sa couleur propre (découpage simplifié
sur ce schéma)
Ø
Le point W représente une couleur sans dominante chromatique :
blanc, noir ou gris neutre.
Ø
Plus on s ‘éloigne de W, appelé point neutre,
plus la pureté de la couleur augmente (pureté maximum atteinte par
les couleurs dont les points représentatifs figurent sur la courbe).
La
représentation dans l’espace fait intervenir une troisième valeur,
la luminance.
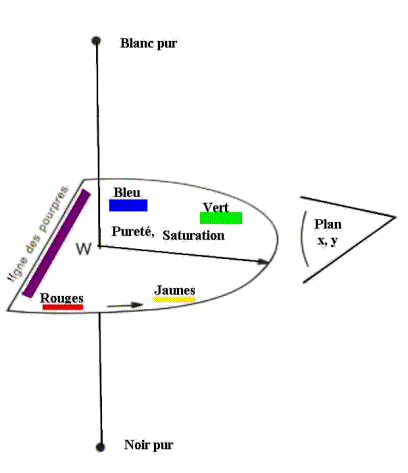
7. Espace des couleurs.
En mesurant, pour une même teinte,
les quantités de lumière ré émise en fonction de la longueur d’onde
variant de 0.4 à 0.7 micron, on obtient les valeurs nécessaires au dessin
de la courbe spectrale de la teinte.
Lorsqu’on a identité parfaite
entre les courbes spectrales et visuellement elles sont parfaitement
identiques.
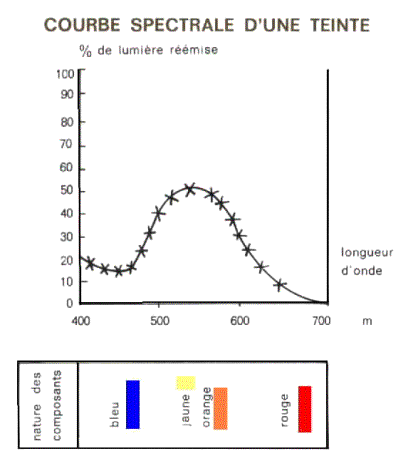
8. La Métamérisme.
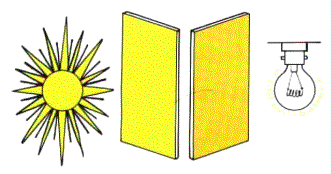
Visuellement, le métamérisme se
traduit par un phénomène d’amplification ou d’inversion d’une
teinte par rapport au type si on change la composition de la lumière
sous laquelle on l’observe.
Exemple : Une teinte
qui paraît légèrement plus rouge que le type sous un éclairage donné
et qui devient beaucoup plus jaune observée sous une autre lumière.
La lumière du jour varie en composition
du matin au soir, la lumière du matin contenant plus d’Ultra -
Violet, celle du soir plus d’infra - rouge. La variation est suffisante
pour mettre en évidence le phénomène de métamérisme.
Généralement, on constate toujours
du métamérisme quand on réalise un contretypage avec des pigments de
nature chimique différente de celle des pigments du type.
9.
Exemple de teintes métamères.
COMPOSITION DU TYPE
Oxyde jaune
Bleu de phtalocyanine
Noir à mélange
Blanc à mélange
COMPOSITION DU CONTRETYPE
Jaune de chrome clair
Bleu de phtalocyanine
Noir à mélange
Blanc à mélange
|
![]()
![]()